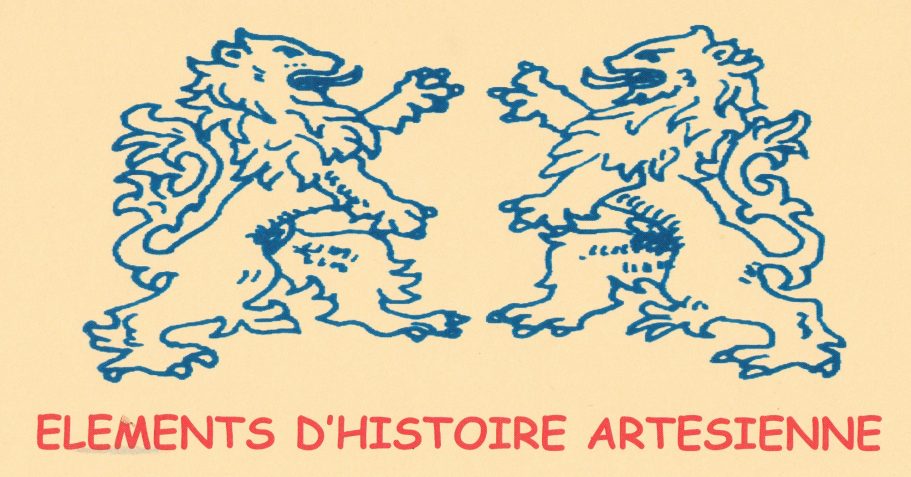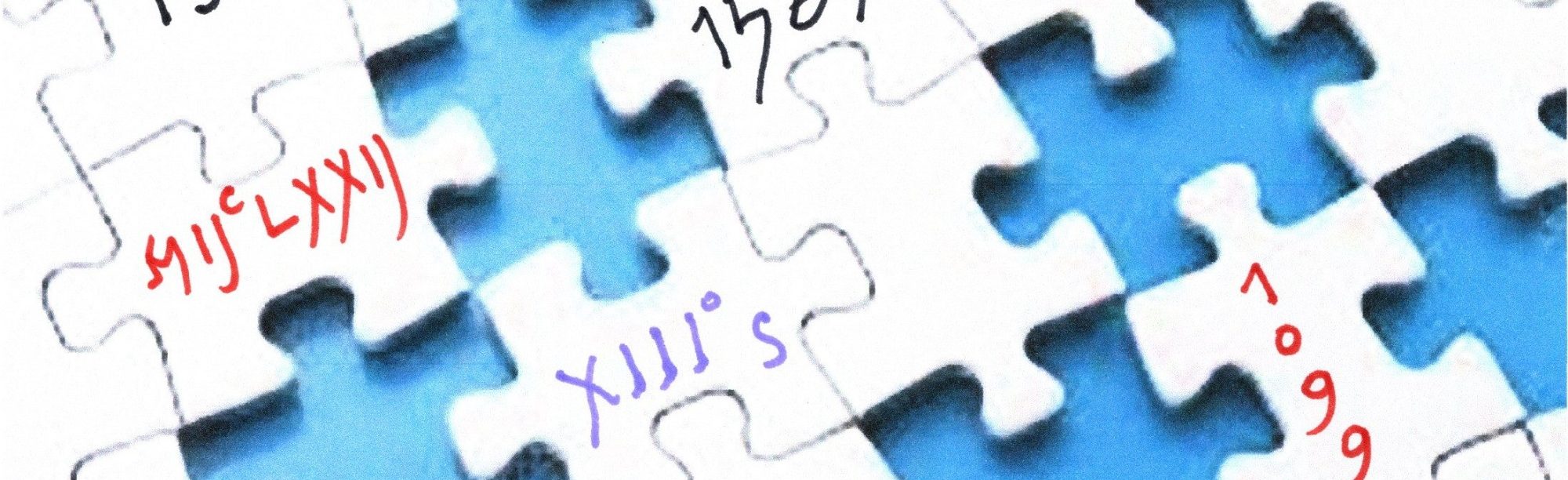Histoire des noms de "famille".
Tout au long de l’histoire,
des « noms » ont servi à désigner les personnes
composant un clan, une tribu, une communauté.
Les conditions du choix des noms ont évolué au cours des siècles.
Dans les civilisations antiques,
un seul nom servait à désigner un individu durant toute sa vie.
Il n’était pas héréditaire.
Rares sont les noms gaulois qui subsistent encore
du fait de la fréquence des invasions.
Les individus étaient désignés par des surnoms attribués par la communauté
à la suite d’évènements particuliers, par exemple :
Vercingétorix, [ Ver (super) + Cingeto (guerrier) + Rix (roi) ],
« le roi des super-guerriers ».
Ces dénominations pouvaient changer au cours de la vie
et étaient toutes occasionnelles et non héréditaires.
Chez les Romains, on utilisait un système de trois ou quatre noms:
le praenomen (prénom),le gentilice (nom du groupe de familles ou de la tribu)
et le cognomen (surnom qui deviendra nom de famille).
A cela, s’ajoutait parfois un agnomen (sobriquet ou surnom personnel).
Les familles illustres utilisaient les trois ou quatre types de noms
tandis que le peuple ordinaire n’en portait généralement que deux :
le praenomen et le cognomen.
Avec l’expansion romaine,
ce système à trois noms s’est étendu sur tout l’Empire
et bien sûr en Gaule.
Les noms d’origine latine sont encore fréquents, surtout dans le Sud de la France.
Les invasions germaniques et barbares du IVè et Vè siècle
détruisent l’Empire romain d’Occident et le système à trois noms avec.
Les populations gauloises retrouvent alors, avec les vainqueurs,
leurs coutumes ancestrales :
ils porteront de nouveau un seul nom individuel non héréditaire.
En France septentrionale,
l’engouement pour les noms francs est très net.
Chez les peuplades du Nord, les noms sont composés de substantifs flatteurs :
Berin-hardt (ours fort) deviendra Bernard.
Au IXè siècle, toute la partie nord de la France
a adopté un nom d’origine germanique.
Au Xème siècle, face aux problèmes posés par un trop grand nombre d’homonymes,
le processus de création des noms de famille s’amorce :
le nom individuel s’accompagne peu à peu d’un surnom et avec l’usage,
ce doublon tendra à devenir héréditaire.
Au XIIème siècle, cette révolution anthroponymique
commence à s’élargir à l’ensemble de la population.
Au XVème siècle, les noms de familles commencent à se fixer
d’autant que le pouvoir politique,
de plus en plus centralisé (royal et ecclésiastique),
réglemente progressivement l’existence de ces noms de famille.
En 1474, Louis XI interdit de changer de nom sans autorisation royale.
En 1539, François Ier promulgue l’ordonnance de Villers-Cotterêts
qui rend obligatoire la tenue de registres d’état-civil.
Cette mission incombera au clergé,
seule « administration » présente sur tout le royaume,
mais nous savons que cette tâche a été loin
d’être appliquée avec le sérieux nécessaire.
Jusqu’alors, l’inscription sur les registres est surtout de tradition orale
(peu de gens savent lire ou écrire, pas ou peu de documents officiels).
Elle sera donc fonction de celui qui parle et de celui qui écoute et transcrit.
Aussi, nous trouverons une orthographe des noms de famille variable :
blazart, blasart…
fené, fenez, fenet…
durietz, duriet, duriez, durier…
lefebvre, lefevre, fevre, lefebure…
ricbourq, ricqbourg, ricbourct, ricquebourct,
ricquebourq, ricquebourg, deriquebourt...
La Révolution Française fera passer l’état-civil de l’église à la mairie.
Désormais, ce sont les administrateurs laïcs qui en auront la charge.
La Loi du 6 fructidor An II de la République (23 août 1794)
interdit de porter d’autre nom et prénoms que ceux inscrits à l’état-civil.
Seul le Conseil d’Etat peut autoriser un changement de patronyme.
En 1870, l’apparition du Livret de famille fixera définitivement
l’orthographe de tous les noms.
Les différents types de nom.
Les surnoms, ancêtres de nos noms de famille,
se répartissent en quatre catégories :
les noms d’origine,
les noms de baptême,
les noms de métier
et les sobriquets.
Les noms d'origine :
Les noms d’origine sont les plus anciens
car souvent liés à une particularité géographique.
On distingue les noms de provenance
avec perte ou non de la préposition « de »
(Dambrines, Darras, Paris, Devillers, De Houdain ou D’Houdain…),
et les noms de voisinage
(Duval, Dumont, Dubois, Dubosquet, Duchêne,
Dufresne, Dumoulin, Fontaine, Delaplace, …).
Ils sont plutôt d’origine rurale.
Il faut donc bien comprendre que le hasard d’une installation
a influencé la détermination du nom ;
ainsi un Duchêne ou Duquesne doit son nom par ce qu’à l’origine
son ancêtre s’est installé près du gros chêne de la paroisse,
il aurait pu se nommer Dutilleul si l’installation avait été choisie autre
ou si l’essence de l’arbre avait été différente !
Les noms de baptême :
Ils apparaissent soit sous la forme pleine (Jean, Jacques, François…),
soit sous une forme diminuée à l’aide de suffixes variés,
rendue nécessaire par la multiplication des mêmes patronymes
dans un endroit restreint (Jacques, Jacquot, Jacquelin, Jacquin…),
ce sont des « hypocoristiques »
ou encore sous une forme composée (Petitjean, Jeanpierre…).
Beaucoup de ces noms de baptême sont d’origine germanique
(invasions des IVème et Vème siècle).
Ils sont plus fréquents au Nord de la France qu’au Sud.
Les noms de métier :
Les noms de métier sont très souvent (mais pas uniquement) d’origine urbaine
car l’artisanat s’est fortement développé et concentré dans les villes.
Ils se développent à partir du XIIIè siècle :
Boucher, Fossier (celui qui bêche), Dufer (le forgeron), Carpentier…
Les sobriquets :
Les sobriquets sont les surnoms dont l’explication
et la signification représentent le plus de difficultés.
Le plus souvent, ils sont issus du langage populaire,
du patois, des particularités linguistiques locales.
Les sobriquets sont en effet les reflets d’une société turbulente,
dure, impitoyable et moqueuse,
qui prend un malin plaisir à railler les défauts physiques
ou moraux de ses congénères (Lepetit, Legrand, Leroux, Lebossu…).
Les noms d’animaux, de plantes ont pu servir aussi
à la génération de noms de famille
(Lecat ou Lechat en fonction de la langue parlée,
Leloup ou Leleu, Lecoq ou Lecocq…).
Tous ces noms de personne se sont formés et ont évolué
suivant la phonétique de la région où ils sont nés.
De plus, ils ont pu subir, ici ou là, des adaptations
ou des transformations linguistiques provoquées par la rencontre
ou la confrontation avec des langages ou dialectes nouveaux.
Ainsi, le « w » germanique se maintient dans le Nord,
devient « v » en Normandie et aboutit à « gu » partout ailleurs
( ex : Waldhari... Wautier... Vautier… Gautier).
Un autre élément est intervenu aussi
dans la formation des noms de famille : la filiation.
Pour exprimer cette notion, on a incorporé les propositions « de » ou « à »
(Jean fils de Pierre Laplace… Jean Delaplace…).
Ce sont ajoutées également, et ce même après le XVIème siècle,
date de leur fixation officielle,
des altérations orthographiques
qui ont continué de faire évoluer les noms de personne.
Dans notre région, la finale « ez » remplace très souvent le « et » ou le « er ».
Autre élément qui est intervenu dans l’évolution des noms de famille,
c’est la capacité du scribe (curé, clerc, notaire…)
à bien transcrire ce qu’on lui a dit
ou à le pérenniser dans la durée, dans le temps.
En conclusion, pour comprendre son « nom de famille »,
il est important d’en connaître la région d’origine,
les formes anciennes du mot,
ainsi que les lois de la phonétique et linguistique locales ou régionales.
Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions
Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.